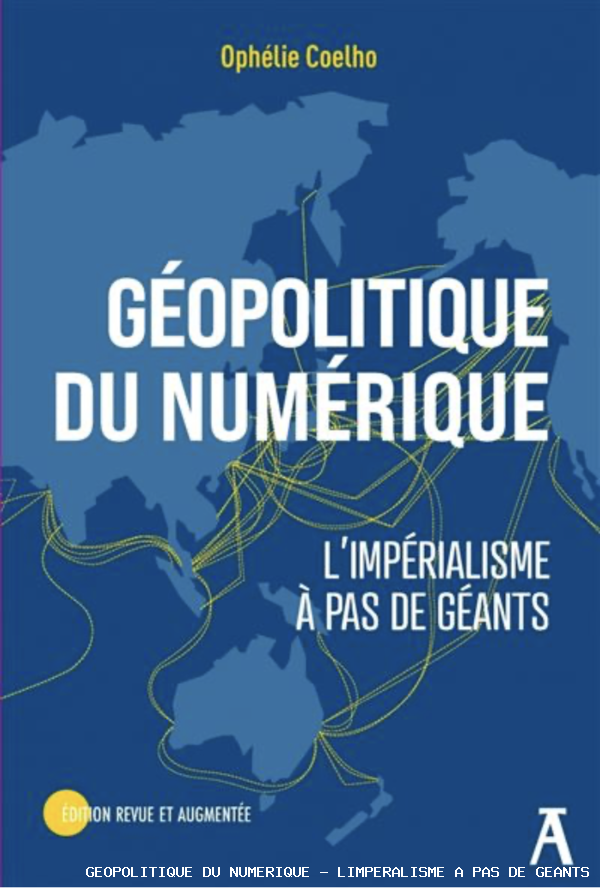Géopolitique du numérique
L'impéralisme à pas de géants
Il y a à peine une trentaine d’années, les technologies numériques étaient absentes de nos vies. Leur arrivée à grande vitesse dans notre quotidien, initiée d’abord par les investissements des États, est aujourd’hui surtout le fait d’acteurs privés. L’approche géopolitique du numérique permet d’explorer la toile complexe des relations de pouvoir qui se tissent entre les puissances étatiques et les multinationales du numérique. Ces géants, Gafam et autres Big Tech, qui détiennent des réseaux de câbles sous-marins, des plateformes de services mondialement utilisées et une masse importante de données, développent aujourd’hui de véritables stratégies d’expansion territoriale. Leur omniprésence a engendré des rapports de dépendance inquiétants qui, avec le temps, risquent même de devenir un moyen de pression ou de négociation auprès des États. Quels risques courons-nous vraiment ? Et comment peut-on (encore) en sortir ? Voyage à la fois historique et géographique, ce livre nous donne à voir un nouveau théâtre d’opérations où, loin de l’utopie d’un internet sans frontières, l’impérialisme technologique avance à pas de géants.
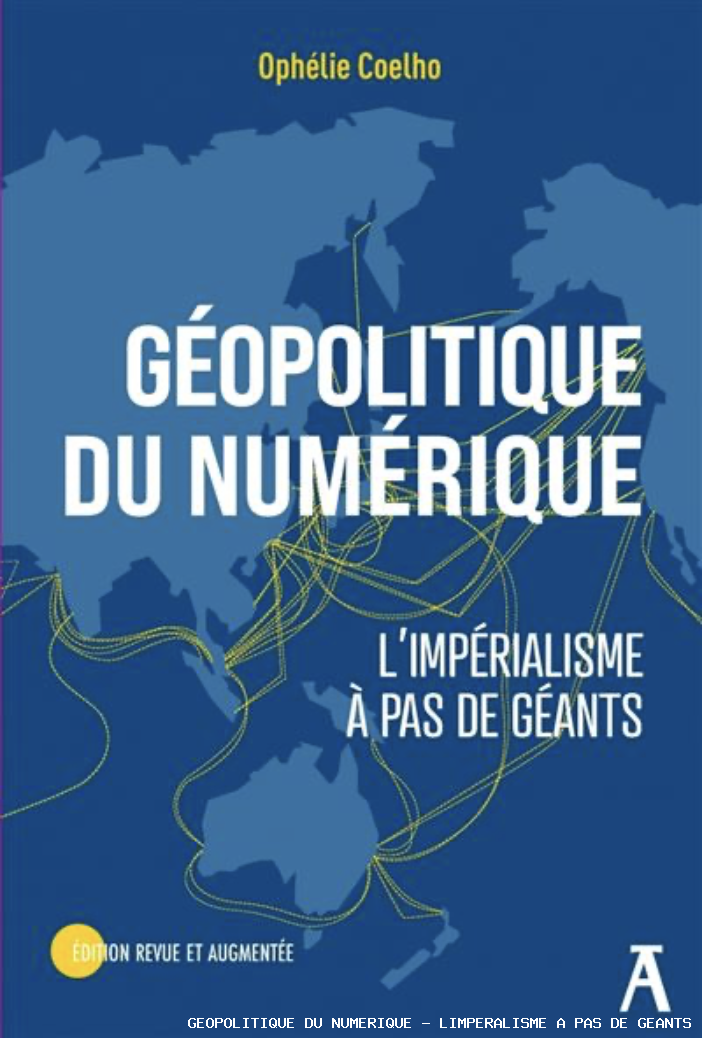
Au début du XXe siècle, l’Empire britannique domine les mers avec une flotte militaire et commerciale sans équivalent, des bases navales dans tous les océans qui font office de guichets pour ses colonies, et le plus grand réseau de câbles sous-marins télégraphiques. Ces nouvelles « routes du fond des mers{1} », bâties et maintenues par les navires câbliers de la Royal Navy, représentent alors un avantage stratégique pour le Royaume-Uni. Reliant les territoires colonisés, la « ligne rouge{2} » est également utilisée par d’autres pays, notamment européens, qui se trouvent de ce fait en situation de dépendance à l’égard des infrastructures anglaises pour leurs échanges extracontinentaux. Cet avantage est mis à profit à plusieurs reprises pendant la Première Guerre mondiale. Ainsi, le 5 août 1914, un jour à peine après sa déclaration de guerre à l’Empire allemand faisant suite à l’invasion de la Belgique, le Royaume-Uni envoie son navire câblier Telconia couper les cinq câbles qui lient l’Allemagne aux autres continents, l’empêchant de communiquer avec ses colonies. La stratégie câblière anglaise entre 1914 et 1918 est même inventive : elle intègre les nouvelles techniques de son temps, dont l’interception des messages envoyés sur le réseau et leur déchiffrement{3}. Par conséquent, avant l’internet global et les réseaux satellitaires à orbite basse, l’Empire britannique faisait déjà, il y a plus d’un siècle, la démonstration d’une militarisation de l’interdépendance dans le cadre des réseaux de télécommunication{4}.
Si les leviers de puissance demeurent, les acteurs de ce jeu de pouvoir ont aujourd’hui bien changé. Auparavant, les États restaient maîtres à bord en investissant et en maintenant un contrôle dans les infrastructures et les entreprises nationales en mesure de créer et maintenir ces réseaux. Mais la seconde moitié du XXe siècle marque un tournant dans l’histoire des technologies de communication.
D’un point de vue technique, d’abord, car avec les réseaux internet, le programme informatique devient un élément majeur des systèmes de communication. C’est à la fois le cas sur l’infrastructure, où les protocoles assurent le transport et le traitement de l’information, mais aussi sur les machines connectées aux réseaux, où les systèmes d’exploitation reçoivent, analysent et transmettent les données. Le réseau SWIFT{5}, utilisé par les institutions financières du monde entier pour effectuer des transactions internationales, repose lui aussi sur un ensemble de programmes informatiques. Enfin, le web est lui-même une couche logicielle qui se fait le portail d’une multitude de programmes informatiques accessibles à distance. En définitive, les infrastructures physiques sont indissociables des différentes couches logicielles qui revêtent, dans de nombreuses situations, un caractère stratégique majeur.
D’un point de vue structurel, ensuite, car les réseaux de câbles, denses et coûteux, connaissent une privatisation progressive en devenant la propriété de consortiums internationaux d’entreprises de télécommunication. Le projet des « autoroutes de l’information », fondé sur le modèle de la Big Science, aboutit à la privatisation de la dorsale du réseau internet dès 1995{6}.
Quand le web devient le lieu de prédation d’entreprises privées, qui fondent leur empire sur le logiciel et l’exploitation de la donnée numérique, la massification des usages transforme l’infrastructure. La couche logicielle acquiert un rôle prédominant dans la gestion du stockage et du traitement des données, positionnant les acteurs puissants du web comme interlocuteurs privilégiés. Depuis quelques années, ils ne se limitent plus à leur activité numérique, mais déploient leurs propres infrastructures physiques qui leur confèrent de nouveaux pouvoirs{7}. Leurs technologies sont utilisées dans toutes les couches de la société, quel que soit le secteur d’activité ou le type d’organisation, qu’il s’agisse d’administrations d’État ou d’entreprises. En conséquence, ils disposent de capacités d’influence reposant sur des mécanismes de dépendance. Leur position est de surcroît renforcée par leur rôle sans précédent dans l’économie mondiale, en tant que partenaires technologiques privilégiés de la mondialisation et puissances financières inédites{8}. Leur position dominante leur confère un levier de puissance sollicité en cas de crise géopolitique. Ainsi, comme peut le faire toute entreprise propriétaire de sa technologie, ils peuvent couper, à des milliers de kilomètres de l’utilisateur final, un service numérique utilisé dans une zone choisie du monde.
Bénéficiant des politiques publiques au nom de la « transformation numérique », les géants du secteur des technologies numériques se sont étendus sur tous les continents. Ils sont les meilleurs représentants et bénéficiaires de la mondialisation. Ils constituent pour les gouvernements, et même pour les États qui les ont fait émerger à grand renfort de soutiens publics, des défis nouveaux, comparables à ceux des précédentes révolutions industrielles qui avaient conduit à l’adoption de réglementations spécifiques pour apprivoiser le pouvoir naissant des grands groupes privés.
L’usage des technologies numériques, omniprésentes dans notre mode de vie contemporain, transforme inévitablement les relations internationales. Cet ouvrage propose d’analyser les enjeux géopolitiques actuels liés au numérique au travers d’un voyage. Celui-ci se veut d’abord historique, partant de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Il est aussi géographique, puisque nous invitons le lecteur à visiter certains lieux de la transformation numérique mondiale : l’Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Afrique.
La première partie offre ainsi une toile de fond du processus de mondialisation et analyse les mutations profondes des relations entre acteurs privés et publics, qui ont posé au XXe siècle les bases de nouveaux rapports de force. La deuxième partie se concentre plus particulièrement sur le développement des grandes multinationales du numérique au XXIe siècle et explore les leviers de puissance apparus avec l’émergence de nouvelles technologies. La troisième partie s’inscrit dans une période plus récente, celle des dix dernières années, et décrit comment les Big Tech établissent de véritables stratégies d’expansion territoriale.
La quatrième et dernière partie reprend ces différents sujets et les examine en tant que notions et outils méthodologiques d’une géopolitique du numérique, puis conclut par quelques pistes non exhaustives vers une meilleure gestion des risques liés à la dépendance technologique dans le monde actuel.
Nous ne prétendons pas, dans les limites de cet ouvrage, énoncer l’ensemble des caractéristiques liées à la géopolitique du numérique, ni présenter tous les leviers de puissance employés par les acteurs publics comme privés. Nous posons tout au plus les jalons d’une étude à long terme, et espérons que le lecteur, qu’il soit amateur ou initié, fermera ce livre avec une meilleure compréhension des phénomènes observés et de Avant-propos
Au début du XXe siècle, l’Empire britannique domine les mers avec une flotte militaire et commerciale sans équivalent, des bases navales dans tous les océans qui font office de guichets pour ses colonies, et le plus grand réseau de câbles sous-marins télégraphiques. Ces nouvelles « routes du fond des mers{1} », bâties et maintenues par les navires câbliers de la Royal Navy, représentent alors un avantage stratégique pour le Royaume-Uni. Reliant les territoires colonisés, la « ligne rouge{2} » est également utilisée par d’autres pays, notamment européens, qui se trouvent de ce fait en situation de dépendance à l’égard des infrastructures anglaises pour leurs échanges extracontinentaux. Cet avantage est mis à profit à plusieurs reprises pendant la Première Guerre mondiale. Ainsi, le 5 août 1914, un jour à peine après sa déclaration de guerre à l’Empire allemand faisant suite à l’invasion de la Belgique, le Royaume-Uni envoie son navire câblier Telconia couper les cinq câbles qui lient l’Allemagne aux autres continents, l’empêchant de communiquer avec ses colonies. La stratégie câblière anglaise entre 1914 et 1918 est même inventive : elle intègre les nouvelles techniques de son temps, dont l’interception des messages envoyés sur le réseau et leur déchiffrement{3}. Par conséquent, avant l’internet global et les réseaux satellitaires à orbite basse, l’Empire britannique faisait déjà, il y a plus d’un siècle, la démonstration d’une militarisation de l’interdépendance dans le cadre des réseaux de télécommunication{4}.
Si les leviers de puissance demeurent, les acteurs de ce jeu de pouvoir ont aujourd’hui bien changé. Auparavant, les États restaient maîtres à bord en investissant et en maintenant un contrôle dans les infrastructures et les entreprises nationales en mesure de créer et maintenir ces réseaux. Mais la seconde moitié du XXe siècle marque un tournant dans l’histoire des technologies de communication.
D’un point de vue technique, d’abord, car avec les réseaux internet, le programme informatique devient un élément majeur des systèmes de communication. C’est à la fois le cas sur l’infrastructure, où les protocoles assurent le transport et le traitement de l’information, mais aussi sur les machines connectées aux réseaux, où les systèmes d’exploitation reçoivent, analysent et transmettent les données. Le réseau SWIFT{5}, utilisé par les institutions financières du monde entier pour effectuer des transactions internationales, repose lui aussi sur un ensemble de programmes informatiques. Enfin, le web est lui-même une couche logicielle qui se fait le portail d’une multitude de programmes informatiques accessibles à distance. En définitive, les infrastructures physiques sont indissociables des différentes couches logicielles qui revêtent, dans de nombreuses situations, un caractère stratégique majeur.
D’un point de vue structurel, ensuite, car les réseaux de câbles, denses et coûteux, connaissent une privatisation progressive en devenant la propriété de consortiums internationaux d’entreprises de télécommunication. Le projet des « autoroutes de l’information », fondé sur le modèle de la Big Science, aboutit à la privatisation de la dorsale du réseau internet dès 1995{6}.
Quand le web devient le lieu de prédation d’entreprises privées, qui fondent leur empire sur le logiciel et l’exploitation de la donnée numérique, la massification des usages transforme l’infrastructure. La couche logicielle acquiert un rôle prédominant dans la gestion du stockage et du traitement des données, positionnant les acteurs puissants du web comme interlocuteurs privilégiés. Depuis quelques années, ils ne se limitent plus à leur activité numérique, mais déploient leurs propres infrastructures physiques qui leur confèrent de nouveaux pouvoirs{7}. Leurs technologies sont utilisées dans toutes les couches de la société, quel que soit le secteur d’activité ou le type d’organisation, qu’il s’agisse d’administrations d’État ou d’entreprises. En conséquence, ils disposent de capacités d’influence reposant sur des mécanismes de dépendance. Leur position est de surcroît renforcée par leur rôle sans précédent dans l’économie mondiale, en tant que partenaires technologiques privilégiés de la mondialisation et puissances financières inédites{8}. Leur position dominante leur confère un levier de puissance sollicité en cas de crise géopolitique. Ainsi, comme peut le faire toute entreprise propriétaire de sa technologie, ils peuvent couper, à des milliers de kilomètres de l’utilisateur final, un service numérique utilisé dans une zone choisie du monde.
Bénéficiant des politiques publiques au nom de la « transformation numérique », les géants du secteur des technologies numériques se sont étendus sur tous les continents. Ils sont les meilleurs représentants et bénéficiaires de la mondialisation. Ils constituent pour les gouvernements, et même pour les États qui les ont fait émerger à grand renfort de soutiens publics, des défis nouveaux, comparables à ceux des précédentes révolutions industrielles qui avaient conduit à l’adoption de réglementations spécifiques pour apprivoiser le pouvoir naissant des grands groupes privés.
L’usage des technologies numériques, omniprésentes dans notre mode de vie contemporain, transforme inévitablement les relations internationales. Cet ouvrage propose d’analyser les enjeux géopolitiques actuels liés au numérique au travers d’un voyage. Celui-ci se veut d’abord historique, partant de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Il est aussi géographique, puisque nous invitons le lecteur à visiter certains lieux de la transformation numérique mondiale : l’Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Afrique.
La première partie offre ainsi une toile de fond du processus de mondialisation et analyse les mutations profondes des relations entre acteurs privés et publics, qui ont posé au XXe siècle les bases de nouveaux rapports de force. La deuxième partie se concentre plus particulièrement sur le développement des grandes multinationales du numérique au XXIe siècle et explore les leviers de puissance apparus avec l’émergence de nouvelles technologies. La troisième partie s’inscrit dans une période plus récente, celle des dix dernières années, et décrit comment les Big Tech établissent de véritables stratégies d’expansion territoriale.
La quatrième et dernière partie reprend ces différents sujets et les examine en tant que notions et outils méthodologiques d’une géopolitique du numérique, puis conclut par quelques pistes non exhaustives vers une meilleure gestion des risques liés à la dépendance technologique dans le monde actuel.
Nous ne prétendons pas, dans les limites de cet ouvrage, énoncer l’ensemble des caractéristiques liées à la géopolitique du numérique, ni présenter tous les leviers de puissance employés par les acteurs publics comme privés. Nous posons tout au plus les jalons d’une étude à long terme, et espérons que le lecteur, qu’il soit amateur ou initié, fermera ce livre avec une meilleure compréhension des phénomènes observés et de l’importance des choix technologiques pour le devenir des sociétés humaines.
Liens
Publié le 07/11/2025 ∙ Média de publication : Les éditions de l'atelier
L'autrice

Ophélie Coelho